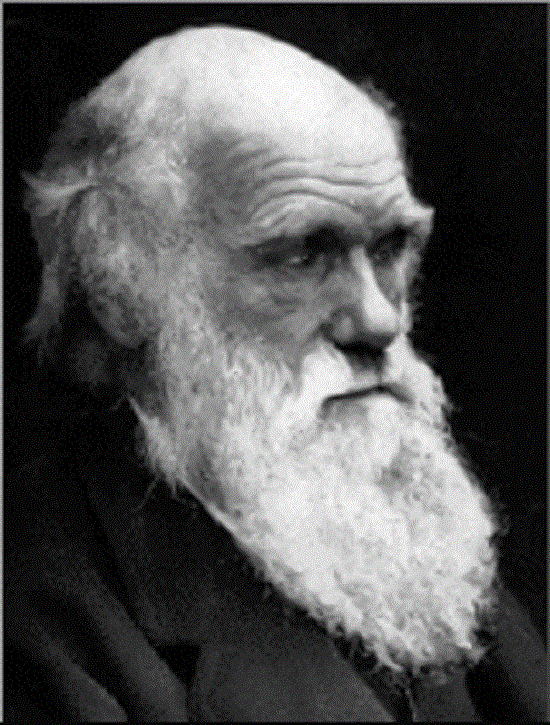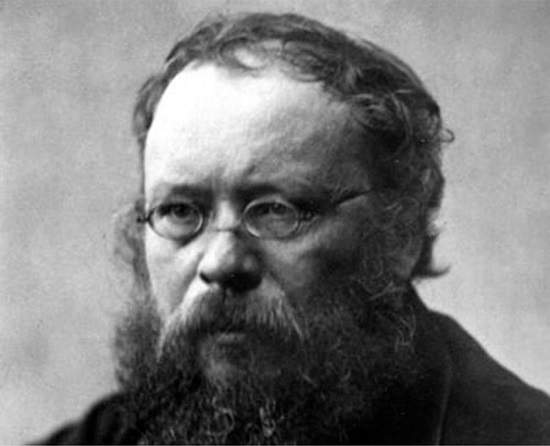Le 1er octobre 1946, voilà exactement 79 ans, est rendu le verdict du procès ouvert à Nuremberg, en Bavière, le 14 novembre 1945.
Sur la base des différents accords intervenus entre les Alliés, ce procès se déroule sous la juridiction du Tribunal militaire international
Le tribunal avait été créé par les gouvernements des États-Unis , du Royaume-Uni, de l’URSS et par le gouvernement provisoire de la République française, afin de juger les dirigeants du Troisième Reich.
24 dirigeants allemands et huit organisations sont traînés sur le banc des accusés et le tribunal doit se prononcer sur quatre chefs d’accusation différents : complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l’humanité, ce dernier point étant une notion partiellement nouvelle.
Le procureur américain a donné au procès son sens profond : « la véritable partie plaignante à cette barre, c’est la civilisation »
C’est le plus grand procès qu’ait eu à connaître l’Histoire et le premier qui ait mis en accusation un régime politique, celui fondé par Hitler en 1933.
Le 18 octobre 1945, le tribunal tient sa séance inaugurale à Berlin. Durant cette séance, l’acte d’accusation est remis au tribunal et aux inculpés. Ceux-ci reçoivent également copie du statut du tribunal et les documents y afférents.

L’acte d’accusation, véritable monument de 25000 mots est divisé en 4 grands chapitres qui correspondent aux 4 chefs d’accusation :
Conjuration et complot : les accusés ont élaboré et poursuivi en commun un plan tendant à la conquête du pouvoir absolu. De même, ils ont agi de concert dans l’exécution de leurs crimes ultérieurs
Crime contre la paix. Les accusés ont dans 64 cas, violé 34 traités internationaux, commencé des guerres d’agression et déchaîné un conflit mondial.
Crime de guerre : Les accusés ont ordonné ou toléré des assassinats collectifs sur une immense échelle, des tortures, la mise en esclavage de millions de travailleurs, le pillage économique.
Crime contre l’humanité : Les accusés ont persécuté leurs adversaires politiques ainsi que des minorités raciales ou religieuses. Ils ont exterminé en entier des collectivités ethniques.
Les pages de l’acte d’accusation sont remplis de détails tellement incroyables, tellement abominables, qu’elles dépassent en horreur les produits de l’imagination la plus morbide.
Mis sous le feu des projecteurs par la présence de la presse internationale, le cours du procès fut plusieurs fois perturbé par des tensions créées par les avocats des accusés ou les procureurs, voire par l’un des juges. Mais malgré ces difficultés et autres incompatibilités de point de vue qui se manifestèrent également lors des délibérations, le procès se déroula de manière assez calme, voire lente pour de nombreux observateurs.
Le procès s’appuie essentiellement sur des preuves écrites, en grande partie issues des archives officielles du IIIe Reich. Si en raison de la procédure anglo-saxonne, qui privilégie l’instruction durant le procès, le public peut s’attendre à des événements spectaculaires, les témoins, interrogés au préalable, n’apportent généralement rien de nouveau lors de leur passage à la barre.
Des 24 accusés présents sur l’acte d’accusation, il n’en restera plus que 21. On retiendra surtout Herman Göring, Rudolf Hess et Martin Borman qui furent condamnés à mort par pendaison avec 9 autres de leurs co-accusés. 3 furent condamnés à la prison à vie, 5 à des peines de prison, 3 furent acquittés.

4 organisations furent également condamné : le parti national-socialiste, la Gestapo, les SS et SD (service de sécurité de la SS)
Le procès de Nuremberg pose certaines des règles reprises ensuite par les tenants d’une justice internationale et reste dans l’Histoire comme la première mise en application de la condamnation pour crime contre l’humanité.
Une seconde vague de procès a lieu l’année suivante. L’un d’eux juge les responsables des SS qui pratiquèrent le génocide par balles en Europe orientale. Il débouche le 10 avril 1948 sur la condamnation à mort de 14 des 24 inculpés
Les procès de Nuremberg ont un grand retentissement dans le monde entier et donnent le sentiment que justice est faite concernant les crimes nazis. Mais il faudra attendre le procès d’un second couteau, Adolf Eichmann, à Jérusalem, le 11 avril 1961, pour que l’opinion occidentale distingue parmi ces crimes la spécificité du génocide.
Le but des procès de Nuremberg était triple :
D’abord dénazifier l’Allemagne en étalant ses crimes aux yeux de tous, ensuite réhabiliter la justice bafouée par le 3ème reich et enfin établir que le mal existe et que la suppression de toute morale, de tout respect de l’homme entraîne le retour à la barbarie.
Comme l’écrit Didier Lazaud dans Le procès de Nuremberg paru en 1947 : « le drame du procès c’est que le retour à ces instincts barbares et l’abandon de cette morale n’ont pas été le monopole de l’Allemagne hithlérienne. L’immense pulsation secrète qui anime l’humanité entière se fait sentir plus ou moins fortement selon les peuples et les époques ! »
L’actualité internationale nous montre qu’il avait raison …
… mais c’est une autre histoire
Écouter l’article avec illustration musicale
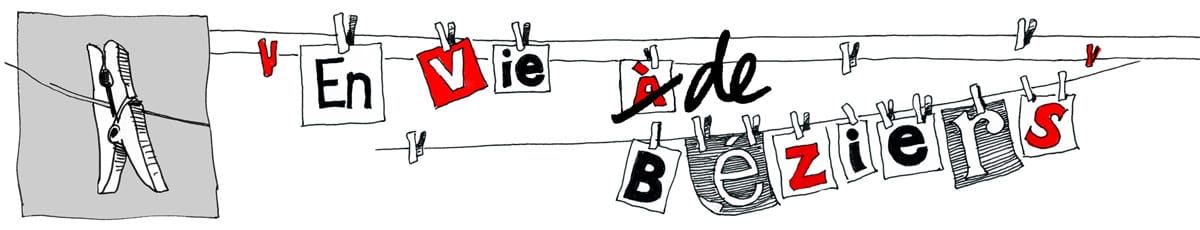


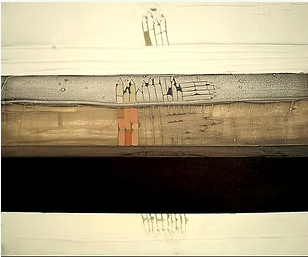

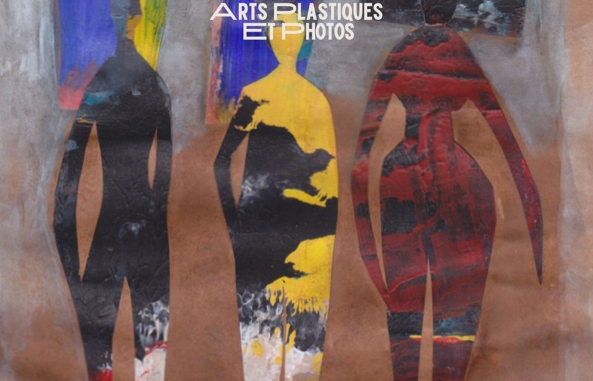

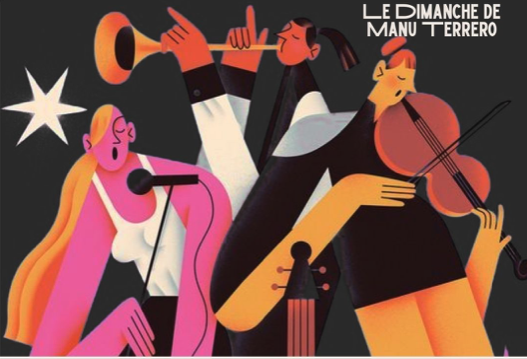
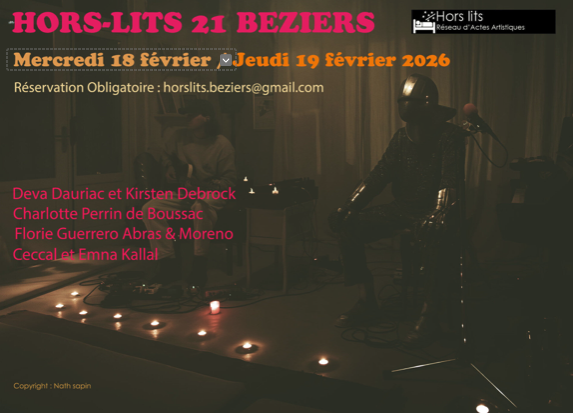
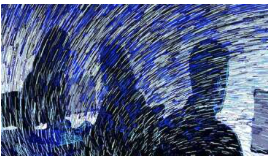




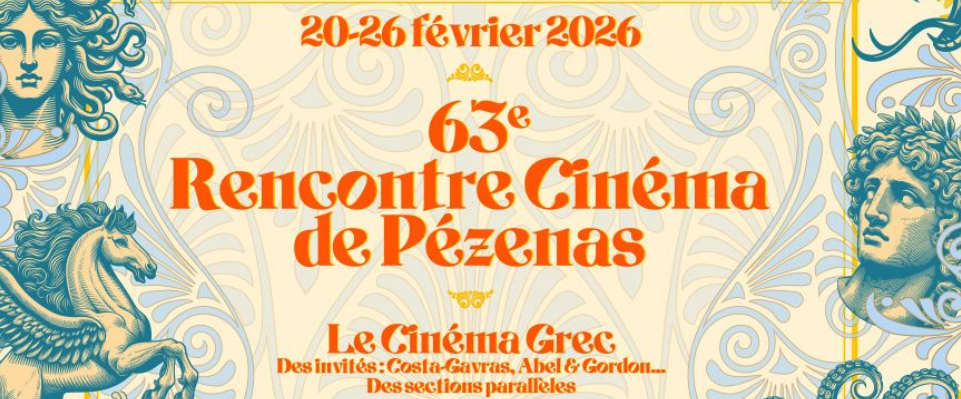

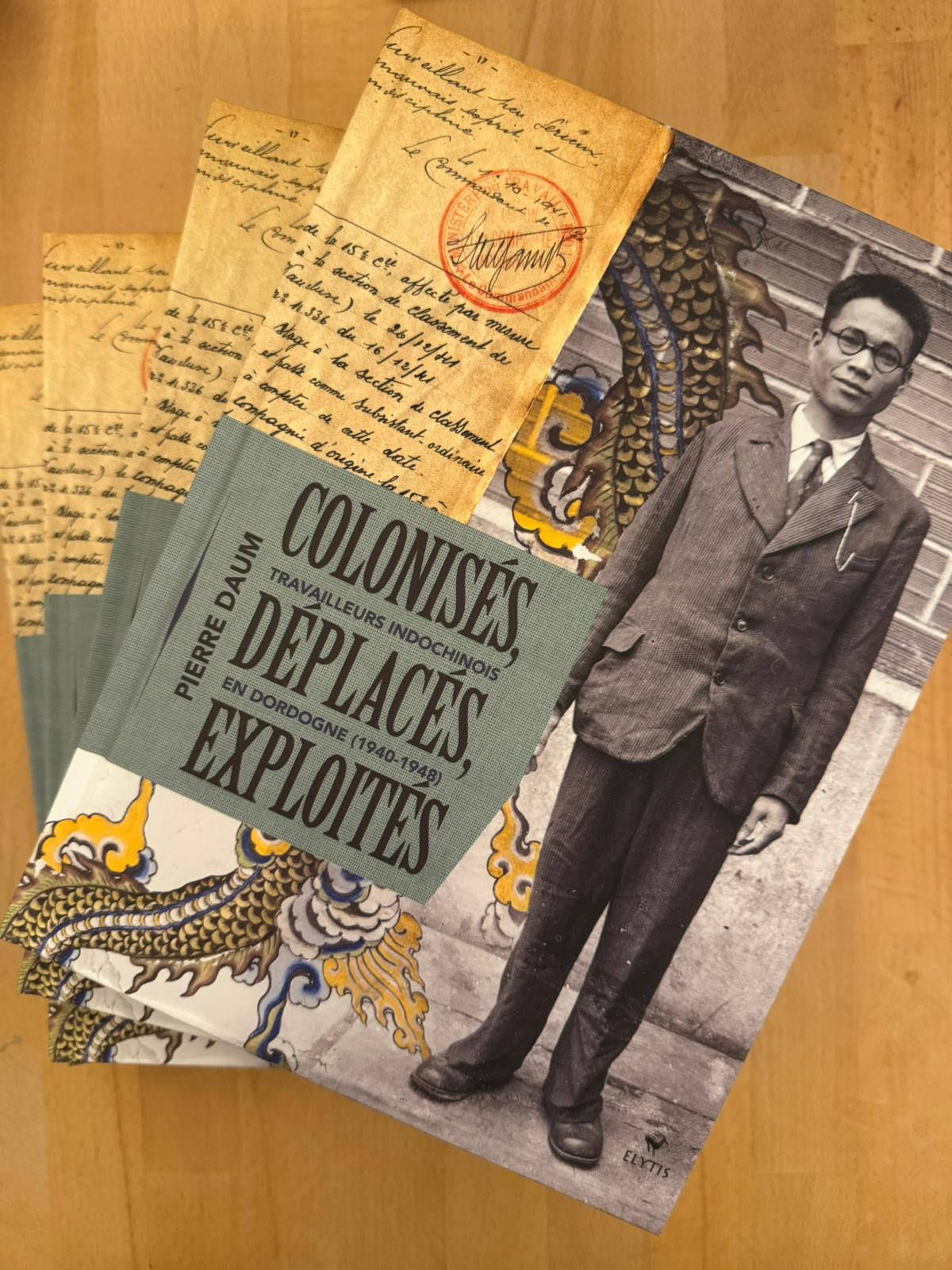



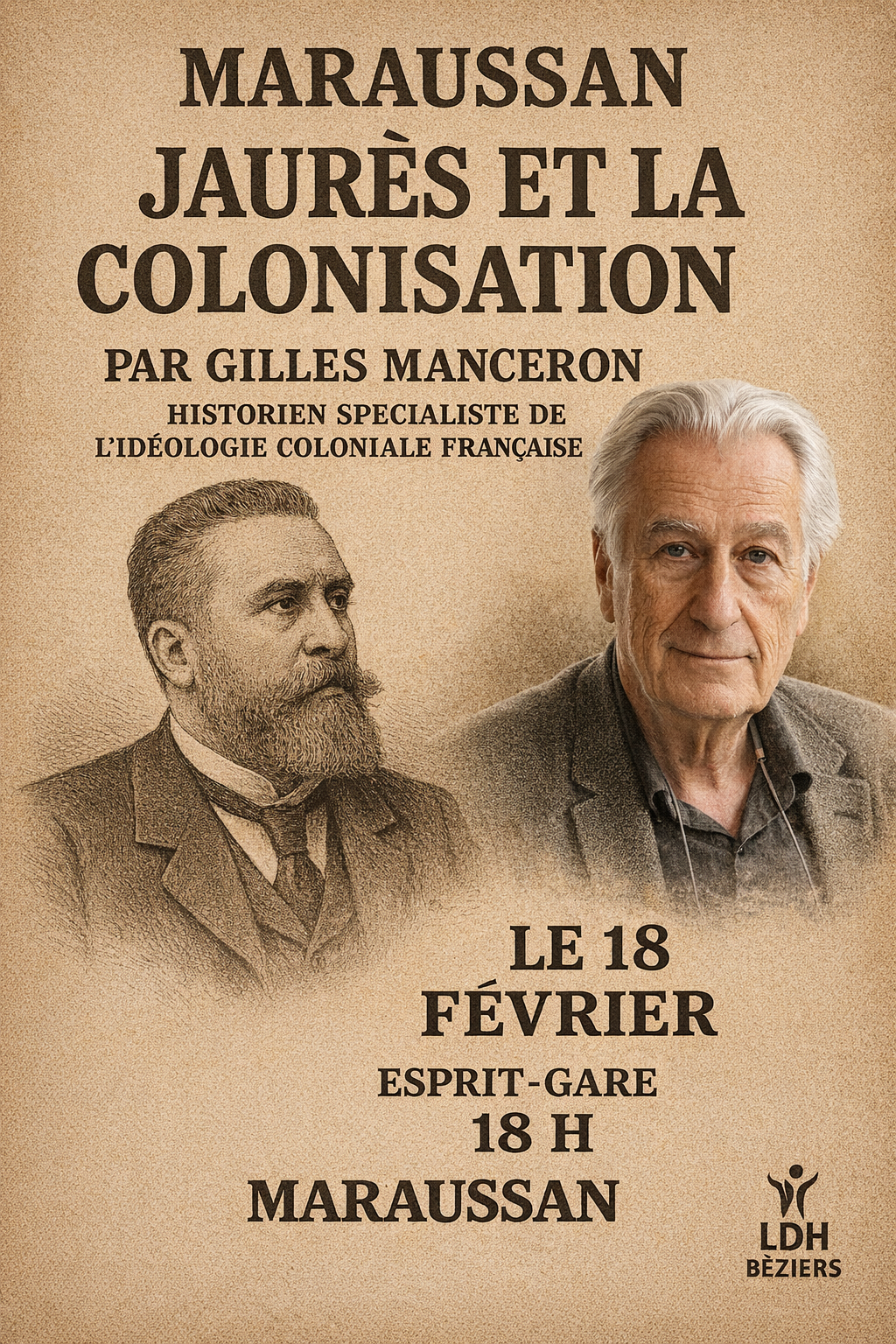

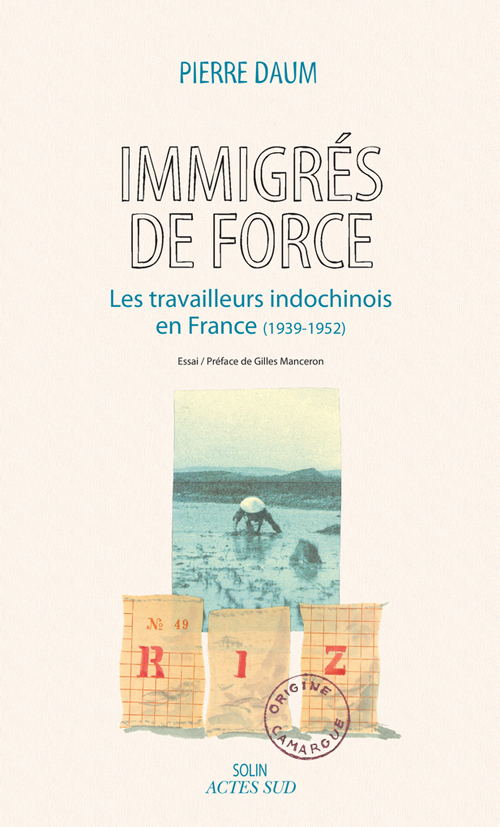



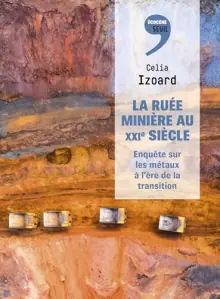
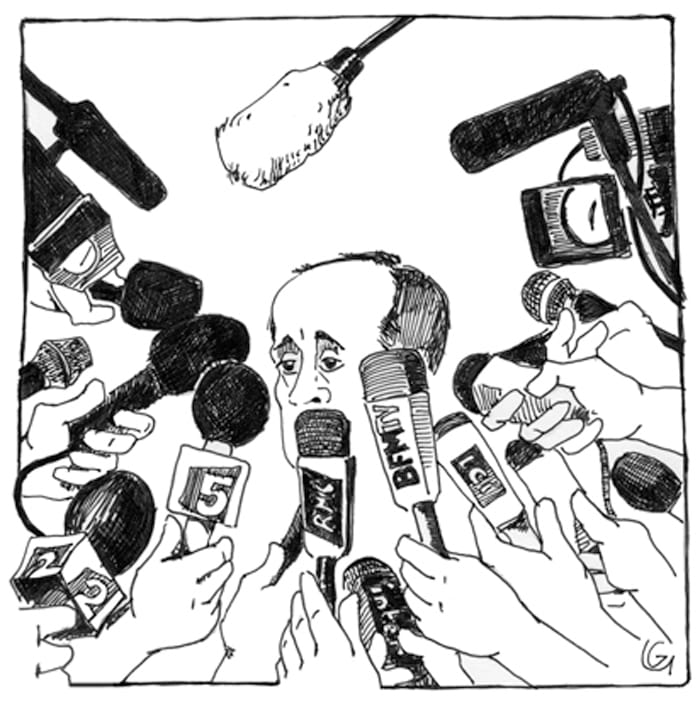








 Total Users : 1063475
Total Users : 1063475